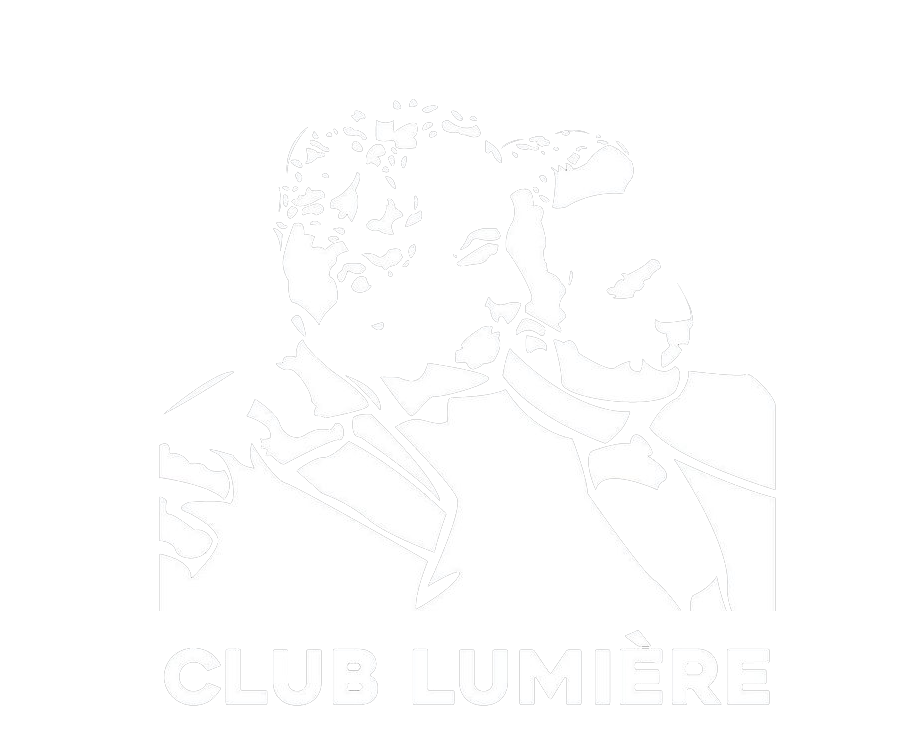Alors qu’il présente son nouveau film Résurrection à Cannes cette année, une tendance naturelle amène à revenir sur les souvenirs laissés par le précédent essai du réalisateur chinois Bi Gan. Un Grand Voyage vers la Nuit, son deuxième long-métrage sorti en 2018, est un film composé de deux parties distinctes, l’une suivant un découpage classique mais narré non-chronologiquement, l’autre étant un seul plan-séquence de 59 minutes en 3D. Le récit nous fait suivre la recherche par un homme d’une femme qu’il avait aimée dans sa ville natale, Kaili. Des histoires de gangsters s’y mêlent, enveloppant les séquences fragmentaires dans un onirisme contemplatif que nous avions évoqué ici.
Le film vogue, si on peut dire, dans un relativisme absolu, où la seule option laissée par le récit est de croire aux chimères. Il offre en effet la subjectivité comme seule certitude où reposer son rapport au monde, dans un brouillard spirituel qui nous fait arpenter un chemin de recherche de la vérité sans jamais pouvoir la trouver vraiment. Bi Gan nous laisse glisser sans but clair dans un flot de mémoire, dans la tête d’une seule personne, sans prétendre pouvoir connaître les pensées derrière les agissements de ceux qu’il observe, sans pouvoir pénétrer la matière opaque sur laquelle ses yeux se fixent. Il reste en quelque sorte spectateur, pas tout à fait une marionnette sans libre arbitre mais à l’agentivité très restreinte, confinée à l’illusion du désir, investiguant de manière forcément limitée les déterminismes de cette histoire d’amour et de violence passée qui nous est relatée.

Un Grand Voyage vers la Nuit, 2018
© Dangmai Films
L’incomplétude de ce récit ne va pas immédiatement de pair avec la restriction du point de vue à un seul regard. Si la sensation décousue et vaporeuse de la première partie du film inaugure cette facette du solipsisme humain, on peut trouver qu’elle marque tout de même des écarts de taille avec l’accomplissement de sa deuxième partie. Le point évident de cette distinction est le plan-séquence, qui, bien qu’il soit frôlé voire manié à plusieurs reprises dans la première partie, ne fait que ronronner un moteur qui démarre après les 1h10 de film.
Le titre apparaît seulement à ce moment-là, Un Grand Voyage vers la Nuit, et il peut s’interpréter d’au moins deux façons : un voyage physique du marcheur qui se déplace avec ou sans but pendant une durée nocturne, ou bien une quête mentale, spirituelle, qui serait de l’ordre du rêve, à laquelle la « nuit » pourrait être une allusion. Il est en tout cas certain que le rêve prend une place importante dans le récit, puisque l’on peut largement comprendre le début du film comme tel, et il constitue de manière plus assurée l’essence narrative de sa fin. Le rêve est cette expérience mentale individuelle, où l’on explore en profondeur notre subjectivité. Y a-t-il vraiment ce que l’on appelle un point de vue ? On semble errer de manière très détachée et désincarnée entre des repères spatio-temporels pas forcément nets, mais nous pouvons partir du principe que nous n’explorons pas la pensée des autres.
Cela, Bi Gan le comprend et en fait une sublimation de la technique de captation de la caméra. Son fameux rêve en plan-séquence d’une heure, par son unicité, nous empêche de quitter le point de vue continu de l’angle de la caméra. Pour aller d’un espace à un autre, il faut y glisser, naturellement ou non, mais de manière toujours sensible, même lorsqu’il faut employer des moyens fantastiques. Le cinéaste propose alors une concrétisation de la subjectivité, c’est-à-dire qu’il présente la séquence onirique comme perception individuelle et offre un contact, un investissement sensoriel de ce lieu mental qui le fait apparaître finalement comme un monde réel. Une réalité choisie très arbitrairement, mais envers laquelle on ne possède aucune réelle preuve de facticité. En se concluant à la fin du plan-séquence, le film ne nous aura pas caché sa nature de mirage, mais il n’en impose pas non plus d’alternative, il a choisi cette particulière chimère qu’il tient pour vrai le temps du métrage et la laisse ensuite s’évaporer dans l’infini, incertitude éternelle du générique et de l’après.

Un Grand Voyage vers la Nuit, 2018
© Dangmai Films
On se rapproche, sous cet angle-là, d’une des propositions du film Suzhou River réalisé par Lou Ye en 2000. Là aussi, on assistait à des illusions, des fantasmes liés à la quête d’une femme par un homme (un scénario à la Sueurs Froides), qui se trouvaient soudainement concrétisés et rendus réels par le poids accordé à ces apparitions par le récit. Tout devient une possible réalité, tout est susceptible d’être réifié sous l’œil de la caméra, qui peut alors faire voir des mirages, comme pour un voyageur dans le désert de la pensée qui croit voir un oasis, symbole d’espoir. Ce désert peut être celui de la ville chinoise, urbaine et post-industrielle dans Suzhou River, provinciale et isolée dans Un Grand Voyage vers la Nuit. Dans les deux cas, on erre dans un lieu fantomatique, où il n’y a pas grand-chose de plus sensé à poursuivre que des spectres, qui donnent de l’espoir, du désir. Ces spectres sont dans nos exemples des femmes, un peu idéalisées (explicitement comparée à une sirène dans le film de Lou Ye), et nous poussent d’autant plus à voir ces voyages personnels comme des expériences très subjectives et mentales, sans attache autre que dans la psyché.
Pour ce qui est de la première partie du long-métrage de Bi Gan, elle n’est pas tant formellement cantonnée à ce principe du rêve que l’on suit un peu happé, puisque la caméra y retrouve son principe ubiquitaire, a la capacité d’être partout, changer d’angle si elle veut et sauter d’un espace-temps à un autre à sa guise grâce au montage. Pourtant, la narration reste très onirique, nous détache des schémas sensori-moteurs particuliers à l’image-mouvement comme théorisé par Gilles Deleuze dans Cinéma 1. On peut la ressentir comme un cristal, dont les multiples facettes renvoient comme un miroir de la pensée ses diverses fluctuations au spectateur. Toutes les temporalités, passé, présent et futur, y sont reflétées et mélangées ensemble, puis stratifiées et offertes au dépliage par les affects de chacun, perçues comme des images virtuelles que décrit Deleuze.

Un Grand Voyage vers la Nuit, 2018
© Dangmai Films
Le découpage propose donc une multidimensionnalité aux rêveries de cette première moitié, par cette certaine manière d’organiser sa chronologie et le rythme de ses plans. Le cinéaste nous introduit ici à cette expérience mentale de plus en plus texturée (une des scènes imite l’impressionnisme avec des points de lumière brouillés par la pluie sur un pare-brise), qui vient achever sa mutation physique dans la seconde moitié, où le plan-séquence est réalisé avec la technique de la 3D et propose cette expérience sensorielle qui ouvre et déploie ce qui était contenu dans toutes les images auparavant, en les canalisant et centralisant dans le cerveau du protagoniste, d’un seul plan. Notre personnage devient dès lors actif dans toutes les situations évoquées en première partie, et a ce pouvoir imaginaire de modifier sous trois dimensions en même temps les tourments dans lesquels il nous a fait naviguer en deux dimensions plus tôt.
Bi Gan propose donc une réconciliation de l’âme, une guérison de la vie, à travers ce voyage intérieur qui choisit consciemment un état de subjectivité comme la seule réalité qui compte pour celui qui l’éprouve. Loin d’un individualisme violent car toujours sujet à modifications, au changement de paradigme, cet état entre contemplation désincarnée et rapport au corps retrouvé illumine paisiblement le mental trop souvent confus d’un spectateur toujours soumis à des structures qui contraignent son corps et aliènent son esprit dans une réalité qui est devenue norme par un consensus général. Doux et libérateur, sans renier la tristesse qui l’anime en premier lieu, le geste de Bi Gan réapprend à accepter une subjectivité qui n’est pas opposée à l’objet, réapprend à trouver un certain stade de lucidité, et tout en même temps, réapprend à rêver.