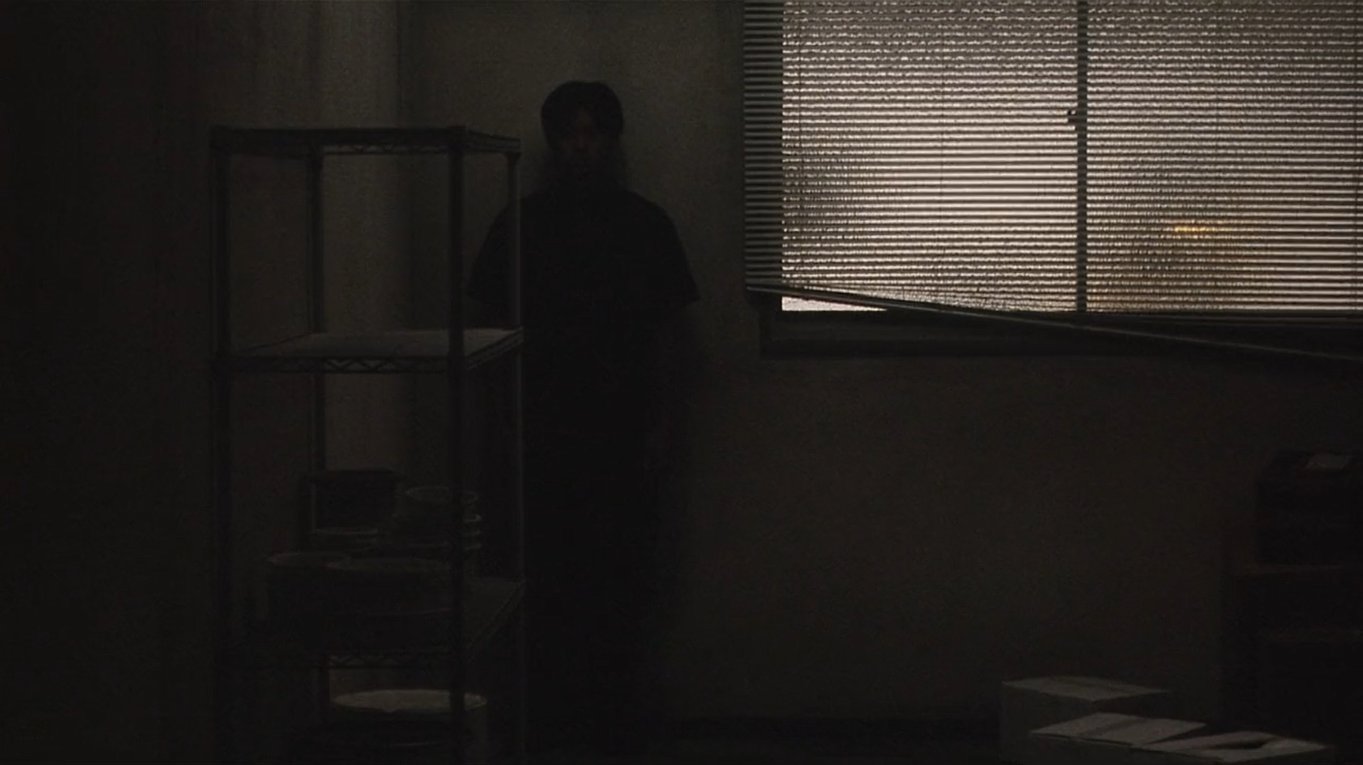Le cinéma de Kurosawa semble être un de ceux qui ont le plus intensément mis à l’épreuve le concept d’identité. D’un côté, fantômes comme vivants, vient en tête l’attitude typique d’un personnage kurosawaien qui consiste en cette posture de l’être qui regarde l’autre, devenu surface cryptique et dont on essaye de percer le mystère (si tant est qu’on ne le fuit pas). La célèbre séquence du couloir dans Kairo peut d’ailleurs être vue comme l’évènement caractéristique de ce principe, séquence où le personnage de Yabe (Masatoshi Matsuo) se trouve nez à nez avec une femme fantôme qui lorsqu’elle avance vers lui effectue des mouvements émancipés de tout rapport de reconnaissance sociale, des mouvements abstraits, presque burlesques (et en ça la scène a pu amuser, tout en provoquant l’épouvante qu’on lui connait). Comme le dit Benjamin Thomas dans son livre Cinéma japonais d’aujourd’hui concernant les dits mouvements: “le corps en tant que référent commun socialement construit est devenu inintelligible, il fait naître l’horreur absolue de ne plus pouvoir se reconnaître dans ses semblables…“. De l’autre, Shigehiko Hasumi, ancien professeur de Kurosawa et célèbre théoricien japonais, pointe cette peur dans son cinéma d’une contamination sans contact, contamination où, toujours dans Kairo, l’autre fantomatique finit par nous rendre semblable à lui, au point où une nouvelle identité se substitue à la première. Si l’observation d’Hasumi n’est pas généralisable au delà de quelques films, cette tension entre une identité qui se dérobe et une qui essaye de se construire, qu’elle soit violente ou non, traverse une certaine période de son cinéma, et conditionne un rapport nouveau à l’espace matériel et temporel, tant pour les images que pour les personnages qui en sont le moteur. Dans ce choc des identités entre elles, via ce malaise qui se généralise dans les moments pratiques des personnages, Kurosawa inscrit le spectateur dans un certain type d’expérience esthétique propre au concept de démenti qui serra défini plus bas.
Car il nous semble essentiel pour comprendre Kurosawa de ne pas considérer son cinéma vis à vis de ce qu’il “dirait” du monde, mais plutôt dans l’expressivité des expériences auxquelles il nous confronte : expérience de l’espace, du temps et de la matière par ses personnages, sa caméra et son montage. Cette mise en expérience apparait traverser, au moins, les films de la période s’étendant de Suit yourself or shoot yourself ! (1995 – 1996) à Tokyo Sonata (2008), auxquels nous nous sentons obligés d’ajouter le récent Chime (2024), qui opère un prolongement de la démarche qui caractérisait les films susmentionnés. Kurosawa sera analysé selon cette idée que sa forme critique passe dans la mise à l’épreuve du spectateur à l’intérieur de formes visuelles et sonores en mouvement qui se confrontent. Il ne pourra être réduit à l’expression de quelconque grande idée figée qui se trouverait cachée au bout du processus, et transformerait ce dernier en moyen aussitôt consommé une fois rallié à une idée abstraite.
Aussi, si nous traitons les films à la lumière de quelques fragments, c’est de manière exagérée pour admettre que leur totalité organisée n’est pas organisée spécifiquement dans le sens du sujet du présent article, mais qu’un choc dans la construction de cet objet fermé qu’est le film a provoqué un rappel, celui d’Hasumi, qu’un film n’est pas “un flux d’images mais une chaîne de plans violemment désolidarisée du monde”, rappel qui nous ramène à la conscience des moments particuliers, restes qui constellent notre mémoire de spectateur. Nous ne disons donc pas que ces fragments n’ont aucun sens compris dans le continuum des films ; justement ! Nous tacherons de ne pas faire des fragments des œuvres à part entière, mais simplement des évènements saisis que le changement d’échelle permet de révéler dans une plus intense manifestation.

Dès que les films confrontent la réalité telle que l’a captée la caméra avec ce qu’à tort nous nous imaginons qu’elle est, toute la charge de la preuve retombe sur les seules images.
Siegfried Kracauer, Théorie du film – la rédemption de la réalité matérielle, 1960
Ce qui vient d’être défini par le théoricien allemand, c’est son concept de démenti. Le démenti, c’est cette mise en tension entre une identité construite par l’organisation de signes iconographiques – ce que nous nous imaginons est une idée reçue, la récurrence d’un cliché, de signifiants reconnus – et une réalité matérielle qui en dévoile l’aspect péremptoire. Si l’image identique est péremptoire, c’est parce que son identité se donne la tache d’accaparer la réalité dans le système représentatif qui l’exprime. Le plan s’offre parfaitement à cet exercice. Délimitée, la réalité qu’il renvoie peut très bien être colonisée complètement par une identité, qui enferme littéralement entre 4 murs les signes matériels dans son système expressif. Le démenti rendrait possible une fuite, une critique de l’identité par une réalité documentaire qui échappe à l’organisation. La dite réalité documentaire peut d’ailleurs se manifester de diverses manières : les signes peuvent manifester une contradiction de ce que pouvait exprimer l’identité, ou simplement exister hors de la logique organisée de cette expression, comme des résidus de réalité inexpressifs, mais qui en fait par leur autonomie et leur altérité nous permettent d’entrevoir un abîme, c’est à dire des formes vides de sémiologie qui peuvent affaiblir une identité dès lors incapable d’enfermer totalement la réalité autours d’elle quand elle se manifeste.
Concernant le premier type de démenti, on citera comme Kracauer cette séquence du Monsieur Verdoux de Chaplin (1947), où après un plan typique du déjeuner en barque sur un lac d’un vieux couple de bourgeois vu en plan large, la caméra se rapproche et révèle le détail sordide du tableau : Chaplin se prépare à tuer la femme. Se rapprocher de la matière signifiée permet d’en révéler une toute autre dimension, une dimension qui nous émancipe du cliché initial. Cette coupe permet d’accéder à la fois à la matière soumise par une identité et à un détail qui vient nier cette soumission par la moquerie, et permet donc l’expérience d’un dévoilement.


Pour le second, l’expérience est d’avantage ambiguë. Il s’agit en effet non pas forcément de nier l’organisation de l’identité en expression, mais plutôt de rappeler ce qui échappe à cette expression, et ainsi établir une tension entre la subjectivité fragile et un espace matériel qui s’en dérobe, qui échappe à sa réduction en tant que signe dans la constellation sémiologique qui compose l’identité. Cette idée, nous l’avons déjà décrite dans cet article à propos de Typhoon Club où nous définissions l’esthétique d’expérience en ces termes. Ainsi, cette dernière peut proposer dans ses formes les plus abouties un moment de démenti, où un signe matériel persistant dans son autonomie est investi par un sujet en mouvement qui le pratique sans réussir à l’accaparer à son identité. Kurosawa a d’ailleurs souvent eu recours à cette esthétique dans la période que nous allons traiter (aussi n’est-ce pas un hasard, vous le voyez venir, si nous traitons de son cas dans le présent article). Le moment esthétique nous immerge dans une chose que seul le cinéma peut nous faire percevoir : une cohabitation utopique entre sujet et objet mis sur le même plan d’importance par la caméra qui ne hiérarchise pas ce qui fait acte matériel dans son cadre.
J’opère un bref retour sur la séquence de jeu dans les flaques de Typhoon club parce que l’envie m’en prend, mais cette dernière m’apparait comme un pied de nez à l’état de fait que décrit ici Adorno dans Minima Moralia : « Le désenchantement du monde sensible est la réaction de nos sens devant ce qui, objectivement, le détermine en tant que monde de marchandise ». L’esthétique d’expérience se manifestant dans la perspective de l’expérience du jeu, la matière physique retrouve une simple valeur d’usage dans l’interaction gratuite. Un vrai bol d’air frais qui porte en lui une émotion puissante, celle de voir en plan fixe des enfants s’émanciper en sautant dans des flaques d’eau, flaques d’eau qui de plus peuvent se targuer de n’être qu’un simple résidu interactif duquel – mais qui sait ce que ce système ridicule peut encore mijoter – aucune marchandisation ne peut être tirée.
Tout ça pour dire que si nous traiterons de Kurosawa aujourd’hui dans la perspective cinématographique du démenti c’est parce qu’il y apporte de nouveaux moments, dont le moteur est à la fois le mystère propre à la tendance fantomatique de son cinéma et son exploration particulière de l’esthétique d’expérience, mais aussi un désir particulier de manifester le travail technique propre au medium comme moment esthétique, ce qui l’amène forcément à réfléchir la notion de réalité, parfois en tension avec l’identité de réel que peut créer sa nature de reproduction au cinéma.

1. Ruines
Dans Charisma (1999) et dans Seance (2000), deux séquences se marient sous l’auspice d’un étrange sentiment lié à l’organisation du cadre. La séquence de Charisma, plus précisément le plan-séquence, prend place dans l’hôpital abandonné où Yabuike (Koji Yakusho, le protagoniste) a trouvé refuge au début du film. Cet hôpital est habité par un jeune homme (Hiroyuki Ikeuchi) et une vieille patiente. Le plan débute sur cette dernière munie d’un plateau garni d’en-cas traversant une pièce sombre de gauche à droite vers le fond de la dite pièce où se trouve Yabuike assis. Elle semble s’adresser à lui comme s’il était son mari, et le prend ainsi par la main pour l’emmener encore plus à gauche qu’au début, au point de sortir de la pièce et d’entrer dans une nouvelle, sorte d’extérieur avec préau extrêmement lumineux où deux chaises et une table symétriquement agencées avaient l’air de les attendre. Ils s’y assoient et la patiente parle, laissant Yakuibe dans une perplexe et silencieuse immobilité. Tout ce jeu d’espace prend forme via un panoramique qui nous révèle la continuité de l’espace traversé par les personnages. Pourtant, ce qui saute au yeux, c’est bien l’étrange discontinuité du dit espace. D’une zone sous exposée, au décors presque exigu et doté de piliers derrière lesquels disparaissent momentanément les personnages, on passe à un espace ouvert, épuré, organisé et pris de face, ce qui accentue l’harmonie de ses lignes. Ce dernier espace marque la fin du mouvement panoramique, et le plan ne bougera plus jusqu’à la fin de la scène. L’espace est donc à la fois uni dans un même phénomène de réalité par la conscience de sa continuité spatiale et matérielle, et fragmenté visuellement, car d’un espace qui ne dégage aucune impression d’organisation formelle on glisse vers une forme organisée. On accède donc à la naissance de l’identité formelle, dans le sens où on observe la trajectoire des différents fragments du moment où ils ne sont pas intégrés jusqu’à leur intégration dans la forme organisée.

La séquence de Séance déploie peu ou prou le même dispositif de plan séquence. Sato (Koji Yakusho encore) et sa femme Junko (Jun Fubuki) se disputent dans leur maison. L’objet de cette dispute importe narrativement, mais c’est surtout l’expérience de dispute qui structure l’articulation des différentes formes organisées. Les deux personnages participent à un jeu d’organisation propre à exprimer leur opposition. Jusque là, rien d’original. Après être passée de la salle à manger au salon (pour l’instant dans le hors champ), la camera opère un travelling et un panorama calqué sur le mouvement de Koji Yakusho, et termine par un surcadrage du salon à travers la porte. Sur le canapé du salon à gauche du plan, le profil de Fubuki alors hors-champ nous est révélé, et Yakusho saisi une chaise afin de se positionner lui aussi de profil, mais à droite. Il est aussi légèrement plus proche de nous. Fubuki préparait donc déjà en puissance une forme organisée que Yakusho a complété en empruntant au décors un accessoire nécessaire à la création d’une forme symétrique signifiante. La forme organisée se compose devant nos yeux, comme dans Charisma.
Deux nouvelles formes se construisent ensuite dans le même plan. La première se manifeste lorsque Fubuki se déplace du salon (arrière plan) jusqu’à une chaise près de la fenêtre (premier plan) créant un nouveau rapport où nous percevons son visage tourmenté et celui de Yakusho qui, ayant pivoté, la regarde lui faire dos, vraisemblablement troublé. La deuxième quant à elle suit la fuite de Fubuki se refugiant dans le hors champ au fond d’une pièce à droite et rejointe par Yakusho, les deux étant maintenant de profil et regardant dans la même direction. Se suivent donc trois formes organisées dans le but d’exprimer une sorte d’intériorité: la symétrie comme une opposition, l’accès à deux émotions faciales en même temps mais qui ne se joignent pas pour dire l’impossible communication, la différence de position dans la profondeur comme un décalage entre les deux personnages et enfin les deux personnages superposés dans le même sens, où Fubuki fait toujours dos à Yakusho pour empêcher la communication. Mais bien que nous ayons passé un certain temps à décrire ces configurations, l’importance de l’expérience filmique que nous propose Kurosawa dans ces deux plan se situe sur une autre échelle.

Dans Charisma comme dans Séance, un espace matériel est exploré de sorte à ce que les personnages et l’espace lui même existent de manière cohérente dans le hors champ, c’est à dire que la réalité temporelle est la même du début à la fin du plan, de la salle à manger au fond de la pièce en passant par le salon. C’est le principe de base de la continuité, chose à laquelle on ne peut échapper dans la réalité empirique mais qui au cinéma est nécessairement rompue par le montage. Ce qui veut nécessairement dire que Kurosawa permet aux existants d’échapper ne serait-ce qu’un temps à la caméra. Les objets et les sujets préexistants donc à leur reproduction filmée, et ce fait étant conscientisé par l’investissement invisible de l’espace hors champ, ils existent un temps sans appartenir à aucune forme organisée, et ne font qu’investir un espace matériel. Là se révèle le rôle particulier de la caméra.
Kurosawa dit dans une interview concernant Séance qu’il veut toujours donner via la caméra l’impression qu’une autre personne regarde les personnages, que ces derniers sont observés. Cette citation, qui peut paraitre un peu banale pour ceux qui se bornent encore à cette ennuyante conception du cinéma comme voyeuriste, nous parait primordiale non pas prise au pied de la lettre, mais parce qu’elle est révélatrice d’une conception interactive retrouvée de l’action de filmer dans l’espace. La caméra redevient un corps qui se meut dans l’espace et capte ce qui se passe devant lui. Dans la perspective des formes organisées qui se composent dans ces scènes, il est nécessaire de la considérer aussi comme un fragment dans la constellation de signes qui organisent la forme, à l’instar du corps des protagonistes et de la chaise utilisée par Koji Yakusho dans Séance ou de la table au millieu de la pièce dans Charisma.
Car il est bel et bien question de fragments éparpillés dans un espace matériel, et qui s’aimantent les uns avec les autres pour devenir une forme organisée. La caméra, comme les personnages interagissant d’une certaine manière avec et dans l’espace, doit travailler un mouvement de recadrage afin de créer une forme signifiante. C’est pour ça que dans Séance, la troisième forme est composée avant que la caméra n’arrive : la position des acteurs nécessite encore d’être scellée par la fin du mouvement afin d’accomplir le but expressif. La caméra est un cadre qui par son action violente d’exclusion du hors champ rend l’expression autonome de l’espace matériel où elle prend place. C’est cette autonomie précisément qu’on appelle ici identité, et c’est cette identité qui est pulvérisée de l’intérieur par la continuité du plan séquence. Kurosawa capte la naissance et la mort de formes organisées qui auraient pu être « violemment désolidarisée du reste du monde ». Mais en nous permettant d’accéder à tous ces moments résiduels où la forme organisée n’existe pas, en nous dévoilant de manière diégétique que la forme est une expérience de composition, il réalise un démenti particulièrement conséquent.
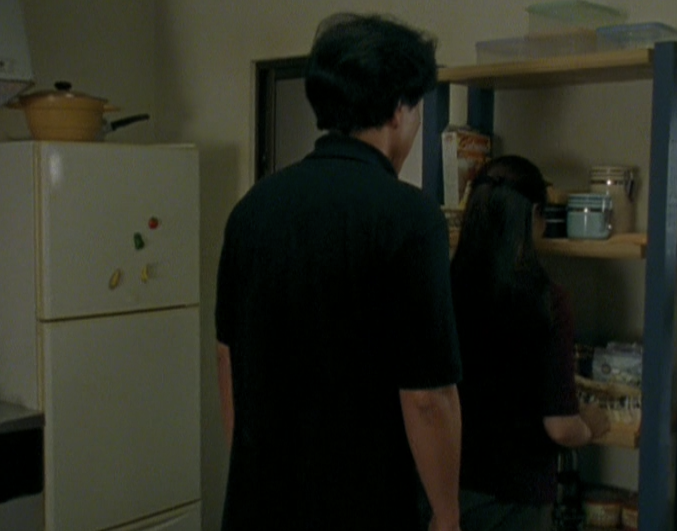
Le mouvement de la caméra existe comme le moment de construction d’une forme, comme l’entre-image révélée du tournage qui passe d’un plan à un autre. Il n’y a plus qu’un seul plan, parce que l’action d’organisation qui se fait pendant le tournage entre les plans est transfigurée dans l’expérience esthétique du spectateur. C’est non pas un sentiment d’artificialité – du moins serait-il réducteur de le nommer comme tel – mais un sentiment intense de dévoilement. Et c’est pour ça que la position immobile et presque sidérée de Yakusho dans la salle avec la patiente est si puissante, parce qu’en tant que fragment d’une composition, il se sent violement autre. Il sait qu’il appartient à l’obscurité, et bien que visuellement il réponde à la symétrie, son extériorité à la situation et au monologue qui fait de lui le mari de la patiente le manifeste en fragment mort qui fait s’effondrer la forme organisée sur elle même, comme illusion de totalité. Le temps narratif d’une forme brisée, d’une organisation vouée à sa révolution, porte en elle l’espérance de fuir l’identité normative. Et c’est aussi pour ça que quand Fubuki se retourne dans la troisième forme, un soulagement nous envahit : parce que la forme touche à sa fin, et que les deux sujets retrouvent une interaction vivante. Ce qui clôt narrativement cette scène est autant une réconciliation de Yakusho et Fubuki qu’une fuite de l’identité de leur dispute.
On assiste là à deux moment particuliers d’esthétique d’expérience. Cette si particulière interactivité des personnages de Kurosawa avec le monde matériel et les autres personnages – en ça il est aussi un cinéaste du contact – se retrouve investie dans un jeu de dilatement de l’identité. Peut être essayerons nous de penser, un jour, ces pratiques fascinantes et toutes leurs étendues.

2. Toucher l’image
A storm at sea (1900) est un court métrage “primitif” de James. H White. Il est composé de deux plans: le premier montre des marins sur le ponton du bateau regardant la tempête, et le deuxième se place au-delà du ponton, ne laissant plus apparaitre que l’océan en furie, comme si nous nous retrouvions nez à nez avec un monstre terrifiant, que la position confortable de spectateur nous était dérobée. On transite d’un partage humain avec les marins à l’apparition du spectacle regardé comme vie autonome. Mais en même temps, cette manifestation déshumanisée exerce une fascination : elle a réservé le plan à sa seule présence, et nous regarde de face. Chez Kurosawa, on accède parfois à ce type d’expérience. Kawashima (Haruhiko Kato), un des protagonistes de Kairo, joue à la salle d’arcade. Il finit par se rendre compte que cette dernière est envahie de spectres. Sur le chemin de la sortie il en croise un en face lui. Et cette fois, contrairement aux autres qu’il a pu croiser sans s’en rendre compte, il décide de le regarder. En plan italien on le voit flou au bord de l’image, tandis que le fantôme se tient devant lui. Car l’important est de le voir orienté vers l’objet de son regard. Et une fois cette correspondance effectuée entre ces deux corps, compris dans le même espace continu de réalité, la caméra se rapproche du spectre. En plan rapproché, sans personne autour, on le voit se mouvoir, mouvement qui désintègre momentanément des parties de son corps à l’instar d’une fumée opaque. Ce type de plan semble arrêter momentanément la narration pour se concentrer uniquement sur la contemplation de l’image du spectre. D’existant particulier dans l’espace, le spectre est devenu un spectacle qui ensorcelle le regard. Kawashima, surement assez effrayé, repousse cette attraction et le plan suivant le montre simplement s’échappant du lieu, comme s’il n’avait pas croisé la route de ce spectre qui ne réapparaitra jamais.

Dans Loft (2005), la momie que garde Yoshioka (Etsushi Toyakawa) se redresse à notre plus grande surprise, bombardée par la lumière dorée du crépuscule. Même si nous n’accédons pas au partage du spectacle (Yoshioka lui faisant dos), nous sommes toujours fascinés par cette vie étrange qui se déploie tout en souveraineté sur l’image. Cette fois-ci, la momie devient corps interactif et finit par entrer en contact avec Yoshioka, en surgissant derrière lui. Son statut d’image se retrouve métamorphosé par la pratique. Elle est en quelque sorte matérialisée. On peut déjà y voir une forme de démenti. Le passage de son autonomie dans le plan à une cohabitation provoque un choc. Jusque là envisagé en tant qu’objet historique ou comme mythe obscur, la voir évoluer dans l’espace matériel et communiquer physiquement avec un autre corps la réinscrit dans le monde et la révolutionne en tant que phénomène. Dans un plan qui uniformise la nature des êtres, c’est par le contact physique que se rompent les barrières entre réalité et surnaturel, et cela provoque une terreur sans précédent. C’est aussi ce qui se passe quand Kawashima touche le fantôme à la fin de Kairo. Le contact ne rend pas confuses les notions de réel et d’irréel, il concrétise radicalement ce qu’on pensait n’être qu’une image « violemment désolidarisée du reste du monde ». Mais dans Kairo et Loft deux autres séquences retiennent notre attention. Elles nous fascinent parce qu’elles convoquent un radical bouleversement dans la perception de la réalité matérielle au stade de sa reconnaissance, qui métamorphose son contenu autant qu’il le prolonge.
Kurosawa a l’habitude d’alterner plans fixés sur pieds et caméra épaule dans une même séquence. Cela provoque un violent choc, qui nous inscrit avec beaucoup plus de proximité dans un espace qu’on a dès lors l’impression d’investir nous même. La plupart des films uniformisent la réalité dans un système continu de représentations techniques. L’exemple le plus cliché serait celui de Yasujiro Ozu dans sa période tardive, auquel on prête la réputation de ne faire des films qu’en plans fixes. Il n’y a ni bien ni mal à reformuler la réalité dans un dispositif continu. C’est même le propre d’un style et Kurosawa n’y déroge pas. Mais le choc que provoque le changement radical de type de prise de vue semble ouvrir la réalité à la pluralité des perceptions. Il n’y a plus une réalité matérielle normative, mais plusieurs moyens d’aborder les mêmes signes matériels. Car en même temps que notre rapport à l’image est révolutionné, les signes persistent. On les reconnait dans leur contenu. Un sentiment de dévoilement nous saisit, à l’instar des plans-séquence de la première partie : la révélation que les signifiants ne sont jamais saisissables dans leur totalité, et qu’un simple changement de prise de vue peut en ouvrir un tout nouvel aspect. C’est ce qui arrive par exemple dans les deux séquences que nous allons aborder.
La séquence de Kairo, met en scène le personnage de Michi (Kumiko Aso), qui accourt rejoindre son ami Yabe dans une pièce où ce dernier s’isole mystérieusement depuis quelques jours. Nous savons qu’il a été victime d’une attaque de fantôme. Un plan fixe large le montre de face collé au mur du fond de la pièce. Un cut fait basculer le type de prise de vue à la caméra portée, caméra qui capte Michi entrer par la porte et se précipiter vers le mur où ne reste plus qu’une trace sombre. On repasse alors en plan fixe large, le son devient sourd et Michi part de la pièce, achevant la scène sur un retour au premier plan amputé de la présence de Yabe. Dans Loft, le personnage de Yoshioka aperçoit celui de Reiko (Miki Nakatani) derrière la fenêtre délabrée de son cabinet de travail, déformant sa silhouette au point d’en faire une apparition fantomatique troublante. Dans un montage alterné, on accède à la fois à l’image aplanie de Yoshioka observée derrière la fenêtre, et à celle qu’observe Yoshioka depuis l’intérieur. Mais c’est Yoshioka qui, attiré par l’image, impulse le mouvement qui abolira les deux images de réalité. On suit soudainement en caméra portée sa main toucher la surface de la fenêtre où de l’autre côté se trouve la main de Reiko. Au plan suivant, à l’extérieur du cabinet, Reiko recule brusquement de la fenêtre; et cette fois la caméra qui la filme pour la première fois (de la séquence) de l’extérieur est portée.
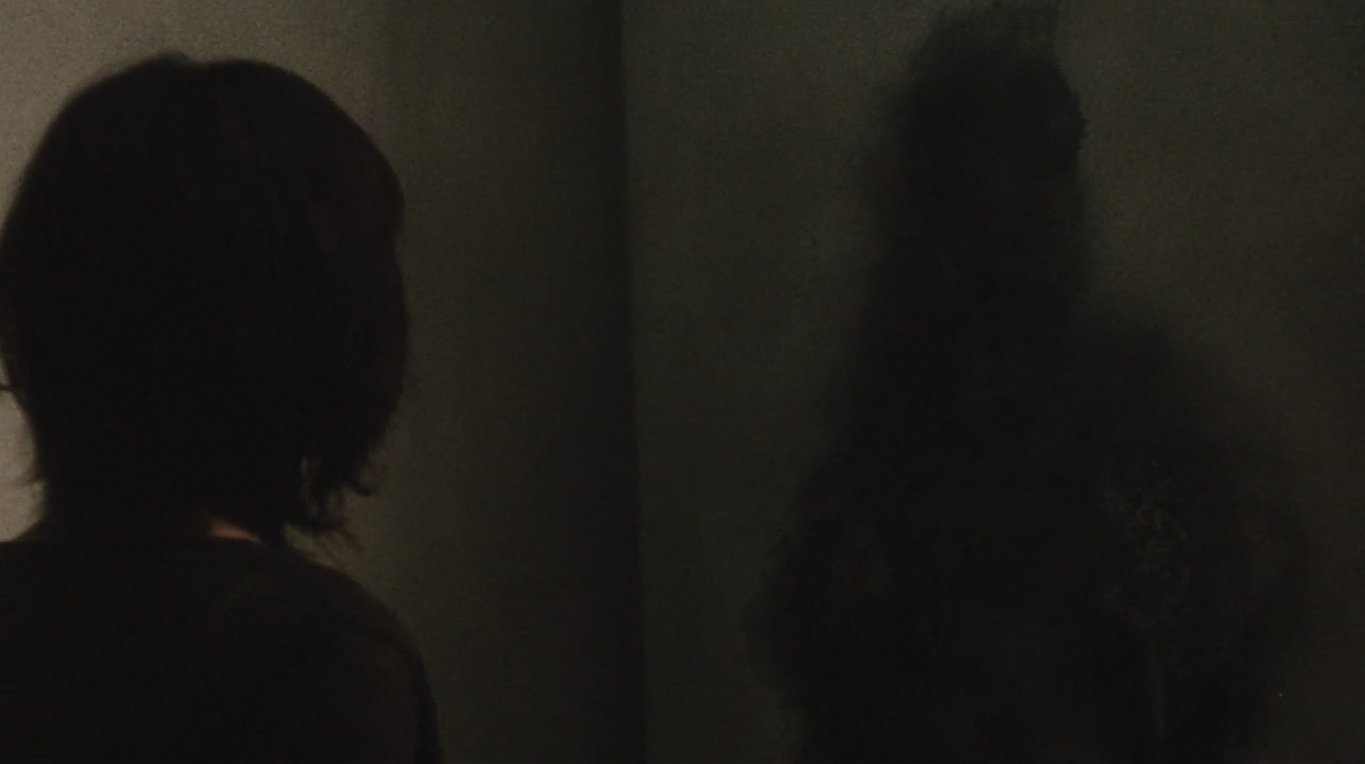
La problématique de la forme organisée en attraction et celle du changement de type de prise de vue sont ici toutes les deux convoquées. Yabe et l’image de Reiko ont tous les deux droit à leur manifestation autonome. Aplatis par la caméra qui les filme de face, et Reiko devenant littéralement une surface plane à cause de la fenêtres, ils se font formes organisées, construisent d’une image leurs identités. Le changement de prise de vue détruit cet état de fait. Les deux protagonistes, en approfondissant l’image qui est en face d’eux, découvrent un nouvel état de la réalité. Comme l’image pour nous, la réalité se révolutionne pour eux. L’ouverture est complète. La séquence de Kairo est de ce point de vue assez abominable pour le spectateur. La réalité matérielle est totalement cohérente, mais un simple changement de type de prise de vue, un simple rapprochement avec la surface d’une image, et voilà que son objet principal s’est envolé. Comment est-ce possible ? Cet évènement n’est en rien vraisemblable, car on sait bien que Michi s’attend à voir Yabe contre le mur. Entre le moment où elle entre dans la pièce et l’apparition du mur par un léger pivotement de la caméra, ce qu’elle voyait n’est plus. Et on ne le voit pas disparaitre. L’objet du regard n’existe qu’hors-champ, comme pour confirmer l’attente d’une continuité qui sera déçue une fois que la présence de Yabe est objectivement niée. Le regard de Michi appelle à une mémoire du plan précédent, et l’invalidité de ce regard scinde alors définitivement les deux fragments de réalité que sont les plans.
En provoquant ce choc perceptif, Kurosawa ouvre au dévoilement du travail cinématographique. Comme lors des plans séquences de Charisma et Séance, ce qui se faisait dévoilement du tournage devient ici dévoilement du montage. Deux reproductions différentes de la même réalité entrent en collision. Rien n’a changé si ce n’est la présence de Yabe, mais cette angoisse soudaine que deux fragments n’opèrent pas la continuité espérée du film nous serre la gorge. Un démenti cruel d’une cohérence ontologique de la réalité manifeste à l’extrême la révolution visuelle du changement de type de prise de vue. S’ouvre un abîme complet. Comme dit précédemment, le même devient autre tout en restant le même. Le signe qui persiste entre deux moments particuliers de reproduction technique du réel se maintient tout en métamorphosant son apparence. Hors au cinéma, il n’est qu’apparence. C’est une expérience fascinante qui ne se désolidarise pas le moins du monde du moment surnaturel vécu par Mishi, au contraire ! C’est une expérience qui contredit autant ce qu’elle identifie de la réalité que ce que nous identifions.
D’un moment horrifique et profondément triste émerge cependant une fraîcheur : la fraîcheur d’une révélation. Les deux plans qui suivent cette révélation instaurent alors un nouveau rapport. Le son s’uniformise dans un silence ponctué d’appels à l’aide chuchotés par la voix d’un Yabe disparu. Michi offre dans un long plan fixe un ensemble de derniers regards qui ne font que croiser le notre : ses yeux regardent la caméra positionnée à la place de Yabe. Elle contemple avec tristesse l’irrémédiable réalité qu’elle a découverte. Le mur étant en hors-champ, on ne peut que désirer la présence de Yabe derrière l’image, en vain. Une fois Michi sortie de la pièce, le plan change. C’est un plan semblable au premier. Mais cette fois la caméra est légèrement surélevée et Yabe est absent. Ce changement d’angle n’a aucune signification métaphorique. Kurosawa opère simplement un bref retour à ce qui était filmé au début de la séquence, fait l’état des lieux d’un changement. L’image qui attirait le mouvement n’est plus, aussi on ne peut plus filmer le mur frontalement, comme avant. La réalité de la pièce s’est objectivement métamorphosée, au sein même de la matérialité de l’image organisée avec les autres. C’est cette fraicheur que porte aussi la main de Yoshioka quand il touche l’image. Un geste sacrilège qui détruit immédiatement cette dernière, arrachant Reiko à la fenêtre.



Un monde en conflit
Le démenti de Kurosawa ouvre donc nos perceptions de la réalité matérielle. Nous pensons même que ces moments de démentis rappellent la conflictualité du monde dans l’expérience filmique. Au delà d’un message à communiquer, les expériences semblables à celles décrites nous immergent dans un monde mutilé. Il laisse au spectateur une réalité ambiguë où des personnages errants expérimentent le monde, tantôt en construisant de belles choses, tantôt en se confrontant à la violence. Une violence qui n’est que la manifestation d’identités mises en difficulté dans leur soumission des signes. De ce point de vu, le père de Tokyo Sonata jetant son fils dans les escaliers manifeste à lui seul toute cette dynamique. Le démenti se situe justement là, entre l’utopie et la tyrannie. Il incarne bien la révélation d’un espace en conflit, un moment où la réalité se dérobe à l’identique et se complexifie, stimule d’autres rapports. C’est dans ce conflit, entre autre, que réside l’expérience filmique si intense à laquelle nous soumet Kurosawa dans ces quelques films.