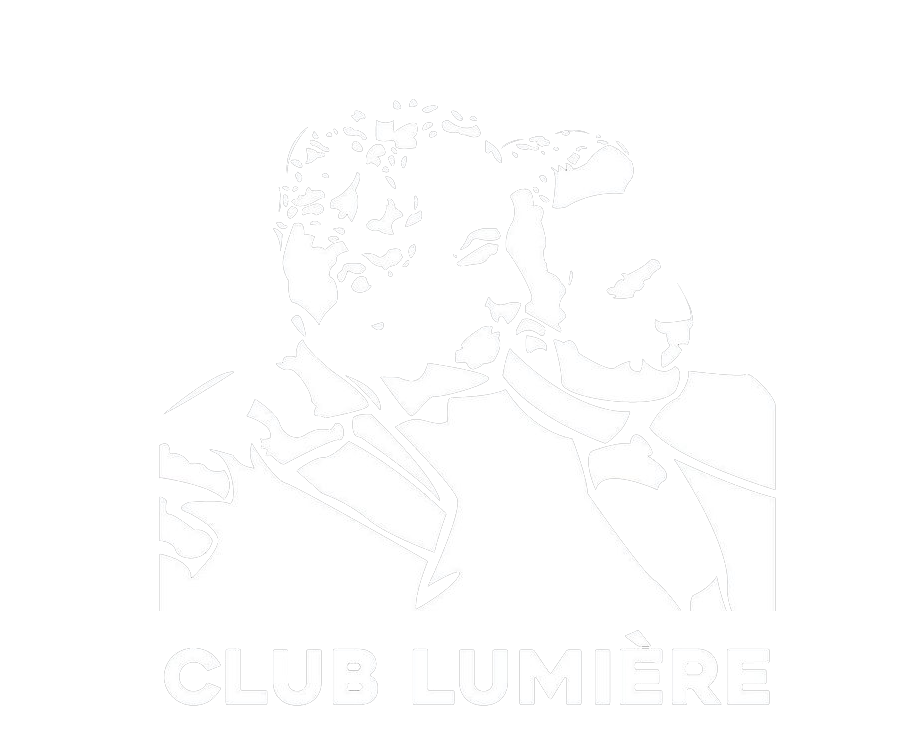Premier temps
Aujourd’hui, au lieu de vous proposer un essai conventionnel, je voudrais plutôt retracer l’acheminement d’une pensée. Une pensée qui aboutit à ce qui me semble être la conclusion inévitable que tire n’importe quel cinéphile qui s’obstine à explorer l’oeuvre du grand maître japonais – c’est-à-dire sa désignation comme l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand des cinéastes – mais qui trouve néanmoins son commencement dans une certaine frustration, ou plutôt une confusion. Cette confusion peut se résumer à la question suivante : Qu’est-ce qui intéressait Ozu, au juste ?
Si l’on jette ne serait-ce qu’un coup d’œil sommaire aux synopsis de ses films, la réponse peut paraître évidente. En dehors de quelques détours dans des genres différents au début de sa carrière, la filmographie d’Ozu se présente comme une série de variations sur des motifs familiers du ‘shōshimin-eiga’ (films petit-bourgeois) – genre dont il deviendra l’un des représentants majeurs chez la société de production Shochiku. Visiblement, il s’est trouvé une niche et y est resté toute sa vie.

Voyage à Tokyo, 1953 ©
Une jeune femme réticente à quitter le cocon familial ; un père tout aussi réticent à lacher prise ; des temps qui changent ; des générations qui défilent. On reconnaît là les topoï sans cesse répétés à travers l’œuvre d’Ozu. Mais justement, il arrive un moment où la répétition est telle que j’en arrive à me demander si ces sujets le passionnent réellement, ou si cette réitération constante n’est que le produit de l’habitude.
On ne doute pas de l’intérêt qu’Ozu portait à ces thématiques récurrentes, et il existe de nombreuses variations au sein de cette constellation thématique. Il assemble ces motifs de manière légèrement différente dans chaque film, leur assignant de nouvelles résonances. Mais il arrive un stade où les variations constantes ne produisent plus l’impression que l’auteur tient vraiment à communiquer quelque chose, un message, une idée, mais plutôt qu’il se contente tout simplement de réutiliser des ingrédients familiers, des ingrédients qu’on s’attend à retrouver dans un film d’Ozu.
Deuxième temps
C’est donc à ce stade de ma réflexion initiale que je commence à me demander si l’intérêt réel d’Ozu ne se portait pas ailleurs, si les sujets de ses films n’étaient pas plutôt la justification d’autre chose. Mais qu’est-ce qu’il reste ? Sinon le fond, alors la forme.
Cette déduction peut paraître un peu hâtive, même naïve, mais je me permets cette naïveté car ici c’est l’exploration des mes impressions authentiques qui m’intéresse. Et je pense qu’en creusant un peu dans cette première impression, aussi superficielle qu’elle puisse paraître, on lui découvrira une certaine profondeur, une certaine vérité.
Quand on parle du style d’Ozu, la première chose à laquelle on pense est sûrement sa mise en scène très stricte. A partir d’une certaine période, il semble appliquer les mêmes procédés stylistiques à tous ses films. On connaît les clichés : la caméra “à hauteur de tatami” ; les plans fixes ; le surcadrage labyrinthique ; les fameux “pillow shots”. Qu’ils soient exacts ou exagérés, ces clichés captent tout de même ce que n’importe quel spectateur remarquera dès son premier visionnage d’un film d’Ozu : la systématicité de son style.
Tout comme avec ses scénarios, nous avons l’impression d’assister à une combinatoire de techniques formelles. Une combinatoire qui contient mille variations, mais toujours au sein d’un même système formel, un même arsenal de techniques. L’expérimentalisme vulgaire ne l’intéressait pas, il cherchait plutôt à épuiser toutes les possibilités de mise en scène dans les limites de ces paramètres formels. A première vue, le style d’Ozu paraît minimaliste, mais il y a un maximalisme dans ce minimalisme ; une densité dans cette simplicité. Surtout après l’arrivée de la couleur dans ses films, qui profère à tous les éléments du plan une existence hétérogène à part entière au sein de la composition.

Fleurs d’équinoxe, 1958 ©
Confronté à un esthétique aussi marquée, le cinéphile a tendance à vouloir l’expliquer par le biais d’interprétations diverses, se focalisant surtout sur l’intention, le ‘sens’ de celui-ci, son rapport au récit et au message de l’œuvre. Par exemple, on serait tentés de voir dans l’uniformité de son style une critique des mœurs sociales strictes du Japon, qui sont quasiment toujours au centre de ses scénarios. On chercherait, par exemple, à faire de son surcadrage la représentation d’un sentiment d’enfermement domestique ; ou de ses champs-contre champs symétriques, une représentation du conformisme social. Mais ce serait, à mon sens, une lecture réductrice qui prive le style d’Ozu de ce qui, pour moi, le rend si unique : son apparente autonomie.
Ces stylismes ne semblent pas découler du récit ou de ses thématiques, mais semblent plutôt imposés de manière presque procédurale. C’est ce que Bordwell appellera dans son livre Narration in Fiction Film un style “paramétrique”. Pour Bordwell, le style paramétrique dénote un détachement de la forme du fond. C’est ce qui arrive lorsque la mise en scène semble suivre sa propre logique de schémas visuels, de rythmes, de répétitions, qui sont parallèles au récit mais ne sont pas réductibles à celui-ci. C’est un style dont l’analyse repose sur l’appréhension des éléments formels. Bordwell oppose la narration paramétrique à ce qu’il appelle la narration “art-cinéma” ou thématique dans un passage où il écrit : “Le besoin de lire les effets stylistiques de cette manière [symbolique] doit aussi être relié à une tendance plus générale, qu’est celle de présumer que chaque film doit pouvoir être interprété de manière thématique. Cette thématisation a tendance à perdre de vue la spécificité du travail narratif d’un film. Chaque élément stylistique est décodé de la même manière : les plans-séquences unifient les personnages, les cuts les divisent ; les lignes verticales isolent un personnage, alors que les lignes horizontales évoquent la liberté ; la caméra subjective donne lieu à des dynamiques de pouvoir en faisant d’un personnage l’objet du regard de l’autre, etc.” (1)
Une mise en scène symbolique est dépendante du contenu thématique de la scène, l’exprime, alors qu’une mise en scène paramétrique trouve sa vraie motivation dans la stratégie de composition générale du film. Ce sont les schémas stylistiques, le jeu de différences et de répétitions, qui sont sa logique première. On pense à Ozu, bien-sûr, mais aussi à des cinéastes comme Bresson, Tati, Godard, ou encore Akerman.
Au cours de sa carrière, Ozu aurait construit un vocabulaire formel qu’il déploie de manière procédurale, selon une logique et une cohérence internes au système.

Bonjour, 1959 ©
Mais alors, ne revenons-nous pas au point de départ ? La systématicité de sa forme ne nous indique-t-elle pas que l’intérêt réel d’Ozu se trouve ailleurs ? C’est ici qu’on trouve le paradoxe Ozu, selon moi. Devant ses films, il m’arrive souvent d’alterner entre deux positions opposées : l’une étant la certitude que les sujets choisis par Ozu, de part leur répétition constante, ne sont qu’une justification de sa forme. L’autre étant la certitude que sa forme est si systématique qu’elle ne peut être que secondaire au récit – un système optimal pour raconter les histoires qu’il avait à raconter de la manière la plus efficace possible. Dans les deux cas, on a l’impression d’avoir à faire à des systèmes qui se déploient de manière quasi-automatique.
Sa forme est-elle adaptée à ses récits, ou ses récits sont-ils adaptés à sa forme ? C’est cette étrange oscillation que je ressens en regardant les films d’Ozu. Cette impression que ses récits tout autant que sa mise en scène, ne sont que la justification, l’excuse qui lui permet d’entreprendre son vrai travail, son vrai geste artistique. Mais alors, où pourrait-on localiser la motivation réelle d’Ozu, son geste artistique fondamental ?
C’est le cinéaste Yoshishige Yoshida, dans son livre sur Ozu, qui a le mieux exprimé cet effet circulaire. Il nous dit : “Parler du cinéma d’Ozu n’est pas une tâche facile. [Ses films] ne peuvent être décrits qu’en utilisant l’expression “ozu-esque”. Le sens de ses films est tel un mirage. Le mirage paraît lointain, alors on tente de s’en approcher. Mais lorsqu’on pense l’avoir atteint, le mirage s’éloigne, nous incitant à le poursuivre à nouveau.” (2)
Troisième temps
Peut-être que le problème ne vient pas d’Ozu, mais plutôt de la nature même de mon questionnement. Cherchant la signification du geste artistique d’Ozu, plutôt que la forme même de ce geste. Une forme qui se retrouve autant dans le récit que dans la mise en scène.
On connaît l’anecdote d’Ozu qui se compare à un simple faiseur de tofu. Cette citation est souvent déployée afin d’exemplifier la simplicité de son travail ainsi que sa quintessence japonaise. Mais je pense qu’en creusant un peu cette remarque a priori anodine, nous trouverons une vérité plus profonde encore. En effet, le cuisinier de tofu est celui qui répète sans cesse la même tâche, cherchant à produire toujours le même résultat. Chaque tofu individuel se doit de conformer à certains paramètres, sans lesquels le produit ne serait du tofu. On cherche donc une sorte de perfection presque platonique, qui transcende la spécificité de chaque tofu individuel. C’est tout une philosophie de travail, une rigueur artisanale.
Ozu, dans son cinéma, ne chercherait-il pas, à quelques variations près, à toujours faire le même film ? Comme si “faire un film” était une vocation artisanale, plutôt qu’une forme d’expression personnelle. Il y aurait quelque part l’idée platonique d’un film – ou plutôt, l’idée platonique d’un film d’Ozu – et le devoir d’Ozu serait de s’en rapprocher le plus possible avec chaque nouveau projet.
Pour atteindre cet idéal, Ozu cherche donc l’équilibre des éléments de sa recette, l’harmonie des formes dans sa construction, la justesse du geste. Cette idée de “justesse” me paraît particulièrement importante. En regardant les films d’Ozu, si on a parfois du mal à expliquer ses choix dans des termes thématiques, on ressent toutefois leur justesse sur le plan formel. Il a choisi le cadre juste. Ce n’aurait pas pu être autrement. On a l’impression d’avoir à faire à une sorte d’instinct architectural ou prosodique.

Fin d’Automne, 1960 ©
Nombreux sont ceux qui ont essayé de projeter une signification symbolique sur ses fameux “pillow shots” – ces plans énigmatiques sans utilité narrative apparente, qui servent souvent de transition entre deux séquences – mais ces interprétations me semblent toujours passer à côté de la vraie valeur de ces plans, c’est-à-dire leur valeur rythmique, intervenant comme le mètre en prosodie. Ils donnent du temps, de l’espace. Ce n’est pas que ces plans ou certains aspects du style d’Ozu ne se prêtent pas à ce genre d’interprétation thématique ou symbolique – je suis persuadé que dans de nombreux cas, ces images contiennent bel et bien de telles significations – mais ces lectures offusquent ce qui distingue le geste artistique d’Ozu de celui d’autres cinéastes bien moins intéressants. Le cinéma déborde de réalisateurs qui infusent leurs images avec des valeurs symboliques, mais bien moins nombreux sont les cinéastes capables de produire un rythme et une logique visuelle aussi uniques et précises que ceux d’Ozu. En se concentrant sur le sens de ses images – sur tout ce qui détourne le regard ou nous fait chercher autre chose derrière l’image – on en arrive à manquer ce qu’Ozu nous donne à voir. On finit par tout voir sauf ce qu’il y a de purement cinématographique dans l’art d’Ozu.
Alors devrions-nous voir Ozu comme un cinéaste expérimental dont les matériaux de construction se trouvent être les tropes du shoshimin-eiga, mais qui aurait pu tout aussi bien être autre chose ? Ozu comme sculpteur d’espaces et de durées. Nous ne serions pas les seuls à le concevoir ainsi. En effet, même David Bordwell le désigne comme le plus grand réalisateur expérimental (3).
Quatrième temps
Mais bien-sûr, ça ne suffirait pas de réduire l’œuvre d’Ozu à une sorte de formalisme abstrait, dont le contenu apparent serait presque accidentel. Ce serait ôter ce qu’il y a de si humain dans ses histoires, ce qu’il y a de si émotif dans sa mise en scène. Il ne faut pas oublier que si le génie d’Ozu se trouve dans son geste formel, ce geste sert tout de même à nous montrer quelque chose, nous faire ressentir quelque chose. Le tofu est fait pour être dégusté. Alors, pour comprendre le cinéma d’Ozu, ne faudrait-il pas plutôt regarder du côté du spectateur ? Quelle est l’expérience de visionnage d’un film d’Ozu ? Ou tout simplement : Comment se passent les films d’Ozu ?
Pour moi, l’effet produit par ses films est celui d’une construction qui s’efface dans sa perfection. Comme si le film n’existait que pour mettre en place les termes de son propre anéantissement. On retrouve souvent dans ses films des personnages qui résistent momentanément à l’ordre des choses, le cours naturel, mais qui viennent inévitablement rejoindre ce flux harmonieux qui traverse le film. Les personnages – en tant qu’éléments du film – sont entourés, encadrés, régis par cette harmonie, cet équilibre qui sont la fin de toutes choses. Les films semblent dire à chacun d’eux : viens, il ne manque plus que toi.

Dernier Caprice, 1961 ©
Chaque chose à l’écran, chaque cut, chaque mouvement est un mur porteur dans cette architecture élaborée dont l’équilibre géométrique ne tient qu’à un fil. Pour Ozu, le cinéma est une affaire de ratios. Chaque chose met en relief chaque autre. Cette maison ne tient en place que par l’accord implicite de chaque élément, sa cohésion avec le reste – une cohésion qui ne peut venir que d’un respect profond pour les choses et les moments qu’Ozu reproduit à l’écran. Chaque chose en son lieu et en son temps. Si un élément est privilégié plus qu’un autre, si cet élément déborde de son cadre, alors l’harmonie sera perdue et le tout en souffrira.
Ozu efface lui-même le film qu’il est en train de faire en délimitant chaque élément d’une justesse qui ne peut produire que sa disparition totale dans l’exactitude de ses contours. Tout comme les ingrédients du tofu qui viennent s’anéantir dans le produit final – les parties d’un film d’Ozu s’effacent dans le tout. Suscitant ainsi ce fameux mono no aware.
Pas étonnant, donc, que Yoshida désigne l’art d’Ozu comme un “anti-cinéma”. D’ailleurs, son analyse s’aligne très bien avec la mienne. Il se demande d’abord pourquoi Ozu s’obstine à ne pas “dramatiser” ou rendre plus stimulantes les histoires qu’il raconte, pourquoi se contente-t-il d’employer des “modes d’expressions cinématographiques si passifs et négatifs – l’imitation, la répétition, les différences triviales”. (4) Selon Yoshida, Ozu était bien trop conscient du fait que le cinéma ne produit rien de neuf. Il ne fait que recopier le réel. Pour Ozu, “ce monde n’est ni signifiant, ni insignifiant ; il se tient là tout simplement. […] Le monde se suffit à lui-même avant que la caméra ne l’envahisse”. (5) Et en envahissant le réel, la caméra le détruit, elle “brouille les conditions réelles du monde”. (6) Faire un film – fragmenter le réel, le remonter, assigner du sens à ces fragments reconstitués – serait un “acte hypocrite”. Yoshida nous dit que le cinéma d’Ozu peut donc être perçu comme une tentative de pénitence pour le péché inhérent qu’est l’assaut de la caméra sur le monde.
Même si cette vision d’Ozu comme artiste autoflagellant me paraît un peu extrême, l’idée selon laquelle on trouverait quelque part dans les films d’Ozu un certain refus de leur propre existence, une volonté de ne pas trop s’imposer, me semble plutôt partinente.
Pour Ozu, faire un film serait donc un travail de reconstitution de l’harmonie à laquelle la caméra dérobe le monde. Mais un tel cinéma ne serait-il pas futile ? Détruire l’harmonie du réel seulement pour le reconstituer dans l’art et en ce faisant détruire l’art. Oui, peut-être. Une beauté inutile. Mais quel plus beau geste cinématographique que celui qui reconstitue une beauté que nous n’aurions peut-être jamais remarquée si elle ne nous avait pas été donnée à voir dans un film ? Ozu produit ainsi un art qui s’annule de la plus belle des manières.
Comme si le but réel était, non pas de raconter une histoire, mais de raconter la manière dont les choses prennent fin, la manière dont elles viennent rejoindre ce flux inévitable qu’est le cours du temps. Tout comme les yeux du spectateur viendront inévitablement retrouver le monde lorsque les lumières se rallumeront. Ozu voudrait que le retour au réel, le réveil après le rêve, se fasse aussi sereinement que possible. Le film n’étant qu’un bref égarement entre les deux rives du réel. Ozu nous dit : Que ce détour lui soit un pont!

Dernier Caprice, 1961 ©
Sources:
(1) Narration in the Fiction Film, David Bordwell, University of Wisconsin, 1985, p. 282
(2) Ozu’s Anti-Cinema, Kiju Yoshida, University of Michigan, 2003, p. 147
(3) Ozu and The Poetics of Cinema, David Bordwell, Princeton University Press, 1988, p. 6
(4) Ozu’s Anti-Cinema, Kiju Yoshida, University of Michigan, 2003, p. 24
(5) Ozu’s Anti-Cinema, Kiju Yoshida, University of Michigan, 2003, p. 24
(6) Ozu’s Anti-Cinema, Kiju Yoshida, University of Michigan, 2003, p. 24