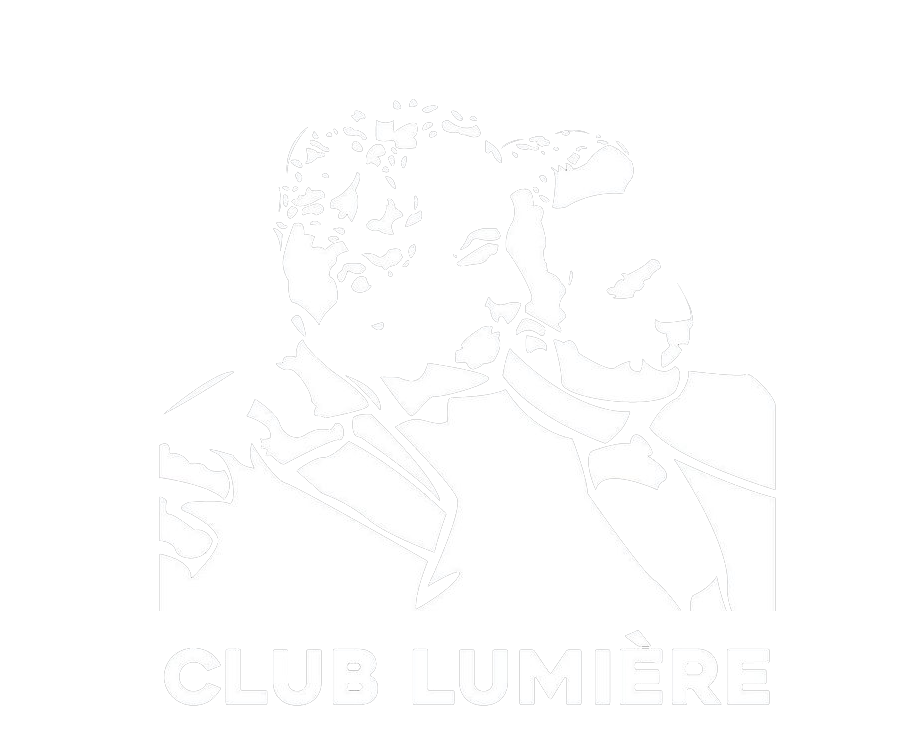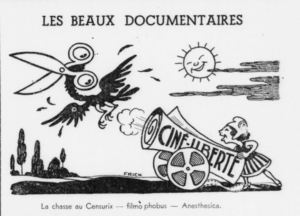Tout film fait partie du patrimoine culturel de l’humanité. Conçu par l’Homme, il est le fruit d’un contexte social particulier, qui peut être interprété sociologiquement. De la comédie la plus naïve au grand film historique, tout film, au-delà de sa réussite ou non, de si on le trouve bon ou non, tout film véhicule quelque chose de nous. Le cinéma a ainsi une certaine appétence pour les sujets historiques, pour l’Histoire.
Le 17 septembre sort OUI ! Le nouveau film de Nadav Lapid, présenté cette année à la Quinzaine des cinéastes à Cannes. L’occasion pour moi de revenir sur un type de films particulier : les films qui font l’Histoire. J’entends par là les films qui non seulement traitent de l’Histoire d’une société, d’un événement réel mais qui sont aussi, dans leur substance même, une forme d’écriture, d’inscription de l’Histoire. C’est-à-dire des films qui réfléchissent à ce que c’est de filmer l’Histoire. Il ne s’agit pas simplement de films historiques, ou de films qui s’emparent de l’Histoire à des fins purement esthétiques, comme 1917 ou Warfare, ces films qui jouent sur un sujet fort en prenant l’excuse de l’immersion pour offrir un grand spectacle esthétique à son spectateur. 1917, grande machinerie hollywoodienne propose à son spectateur de vivre en continu 1 heure et demie de la première guerre mondiale. Warfare propose lui à son spectateur de vivre une opération militaire américaine, volontairement décontextualisée, afin d’immerger le spectateur dans l’adrénaline d’une opération de l’armée. Comme si cela avait même un sens, un intérêt. Comme si cela était même possible de faire vivre la guerre à son spectateur, ce qui est la promesse de ces films. Pour ce type de films, il y a une forme de limite par essence qui empêche la promesse d’aboutir, et c’est bien heureux que la promesse n’aboutisse pas. Moralement, vouloir faire revivre à son spectateur la guerre, la mort, comme la fameuse bataille d’introduction d’Il faut sauver le soldat Ryan pose beaucoup de questions que ces cinéastes (Spielberg en l’occurrence) ne semblent pas du tout se poser.
Je cherche plutôt à me questionner sur ces films de fiction qui racontent quelque chose qui devait être raconté, et qui n’aurait pas pu l’être autrement que par le prisme du regard particulier du ou de la cinéaste. Des cas où l’esthétique des films se marie pleinement à l’événement ou la période dépeinte, en parvenant ainsi à capter visuellement des non-dits, des atmosphères ou des contre-histoires en offrant des points de vue différents sur les choses. Des angles nouveaux, qui permettent de proposer une vision de l’Histoire ouverte au spectateur, plutôt que des films qui restent cloisonnés dans la vision dominante de l’Histoire.
OUI ! de Navad Lapid, une relecture de Lili Marleen au présent, et en Israël
OUI ! Fait partie de ce cercle réduit de films sur lesquels j’aimerais revenir dans cet article en essayant de démontrer à chaque fois comment ils apportent une vision nouvelle ou cristallisent les événements qu’ils traitent en leur sein, en leur matière propre. OUI ! Est le premier film israélien à affronter explicitement la question du traumatisme du 7 octobre et des massacres qui ont suivi, et suivent malheureusement toujours. Beaucoup de choses vont sûrement être dites sur ce film, sur son excès de forme, sur son audace. Je dirais pour ma part que cette version actualisée du Lili Marleen de Fassbinder est d’autant plus puissante que les compromissions artistiques dont il est question dans les deux films semblent plus proches de Lapid que du cinéaste allemand. Rainer Werner Fassbinder fait partie de la génération d’allemands nés en 1945, comme Wim Wenders (on y reviendra), celle qui doit composer avec le passé de l’Allemagne, avec le nazisme des pères. Le protagoniste du film de Nadav Lapid est son contemporain, le film ne traite pas de la génération d’avant, il confronte les israéliens du présent, dont Lapid fait partie. On écrit beaucoup qu’il fait une satire acerbe de la société israélienne mais c’est aussi une forme d’autoportrait qu’il filme d’une certaine façon. Je ne dis pas que Lapid est le compositeur, loin de là, mais qu’il ait choisi un personnage d’artiste pour son film n’est pas anodin. S’il ne parle pas de lui, il parle du moins des siens, de son milieu. Lili Marleen raconte l’histoire vraie, mais romancée, de Lale Andersen et de la musique éponyme. L’histoire donc d’une chanteuse de cabaret allemande, amoureuse d’un résistant juif aux aurores de la Seconde Guerre mondiale qui, par opportunité de carrière, se retrouve en figure de proue du régime nazie et de la propagande de guerre. Le compositeur de OUI ! se voit proposer de composer une musique de propagande pour le régime israélien, une sorte de nouvel hymne national.

Le film confronte la population israélienne, en particulier la caste des petits-bourgeois artistes de Tel Aviv, à l’ivresse de leurs fêtes, à leurs modes de vie plus que confortables. Et surtout au choc provoqué par l’attentat du Hamas datant du 7 octobre, jusqu’à la nausée de l’excès totale de la réponse militaire apportée par le gouvernement israélien, avec ses désirs de conquête territoriale et d’extermination du peuple Palestinien. Ce peuple est absent du film, mais il rend cette absence concrète, potente lors d’une scène de hors champ assez mémorable. L’esthétique de Lapid se fonde, comme la réponse du gouvernement israélien, sur l’excès. Excès de sens, excès de formes. Avec son montage qui renvoie aux expérimentations des cinéastes surréalistes comme René Clair et son Entr’Acte, la caméra du cinéaste israélien explore les visages, la ville, avec des très gros plans aux mouvements vifs. Esthétique de l’excès, de la nausée, de l’élan incontrôlé qui décompose les formes, les êtres, l’architecture des visages et des bâtiments. Le film bouleverse la vue du spectateur, lui proposant des visions fortes, nouvelles qui déconstruisent son regard sur le monde.
Grâce à cette esthétique particulière, qui fait le sel du cinéaste, le film nous « donne des nouvelles » de la société israélienne pour reprendre des termes de Serge Daney. Je crois, comme lui, que le cinéma a en lui cette fonction de donner des nouvelles des sociétés humaines, des modes de pensée, des traumatismes. Et des nouvelles de la société israélienne, on ne nous en donne pas si souvent : les médias pointent plutôt en avant les esprits virulents, les pro-génocide et les contre. Enfin un film nous montre quelque chose, quelques âmes, qui se situent entre ces deux pôles. Quelque chose qui se situe au milieu, qui n’a plus vraiment sa place dans la polarisation constante des appareils médiatiques. L’introspection que nous donne à voir Nadav Lapid sur son pays restera, je pense, une œuvre d’art qui transmet le point de vue rarement montré d’un artiste israélien qui confronte son pays, qui est partagé entre la honte et la peine, entre le traumatisme du 7 octobre et le traumatisme de ce qui est en train d’arriver en Palestine. Une introspection virulente qui exprime son fond par sa forme en trouvant un juste équilibre entre son esthétique virulente, nerveuse, instable et le fond du sujet qu’il traite sans complaisance. Le film est rude, éreintant même, ce qui est probablement dû à sa différence principale avec Lili Marleen. Le film est réalisé au présent de son histoire là où le film de Fassbinder sort une trentaine d’années après la seconde guerre mondiale. La temporalité qui séparait l’histoire dépeinte du spectateur mettait à distance, d’une certaine façon, les événements mis en scène, qui étaient de toute façon abordés moins directement par le cinéaste allemand. Ici l’horreur est le sujet, le film ne se cache pas, ne se réfugie pas derrière quoi que ce soit, il confronte. Ce faisant, il écrit l’histoire du présent, il le fige en le filmant.
Raconter la guerre, questions de points de vue (Rossellini, Melville, Glazer, Wenders)
La guerre et la vie pendant la guerre sont des sujets particulièrement traités au cinéma. Il faut dire que l’histoire du 20e siècle a été parsemée de guerres. Des deux grandes d’abord puis de nombreux conflits plus localisés issus de la Guerre Froide. Sur la seconde guerre mondiale en particulier, il existe des milliers de variations de thèmes, d’angles, d’histoires traités au cinéma. Je vais m’arrêter sur celles qui sont à mon sens les plus pertinentes cinématographiquement parlant. Celles qui se rangent avec OUI ! du côté d’un cinéma qui s’interroge sur l’Histoire, à la façon de l’écrire, de la rendre présente, concrète sans pour autant être immersive. Le tout récent Zone of Interest de Jonathan Glazer a comme point commun avec le film de Nadav Lapid de s’interroger sur l’indécence des bourreaux, l’indécence de continuer sa vie comme si de rien était à côté de l’horreur humaine. Dans ce film de Glazer, on nous montre tout en ne montrant rien, il est encore une fois question de hors champ. Toute l’idée esthétique du film est de rester juste à côté, en montrant la petite vie quotidienne d’une famille d’un commandant SS qui s’occupe d’un camp d’extermination.
Le hors champ est central dans les deux films, bien qu’ils le construisent différemment, du fait de leur ton. Dans le film de Jonathan Glazer, le hors champ des camps de concentration est brisé par des traces, des indices parsemés ici et là dans le cadre. Des cendres, des colonnes de fumées, des vêtements sales. Dans le film de Nadav Lapid l’indice est moins visuel qu’auditif, de violentes alertes sonores assourdissantes ponctuent le film en donnant le bilan progressif des victimes palestiniennes du conflit pendant que la petite vie des personnages du film continue. OUI ! joue donc en quelque sorte sur les mêmes ressorts que Zone of Interest : comme lui il montre la vie juste à côté de l’horreur, comment elle continue, comment même la rage contre l’autre s’installe, jusqu’à justifier toutes les atrocités commises au nom du droit à se défendre. Le film monte progressivement du côté de l’horreur et de la culpabilité, jusqu’à une séquence de fin tranchante où est enfin dévoilée la musique composée par le personnage principal, une musique de propagande atroce accompagnée d’un clip qui l’est tout autant, qui appelle à l’extermination des Palestiniens. Là, le film de Lapid brise la fiction et rejoint le réel : cette musique existe vraiment. The Zone of Interest est construit différemment, sans réel crescendo ni violence nerveuse. Tout y est indifférence, ou pire, négation. Jusqu’à cette fin qui montre le lieu de vie de la famille au présent du film, rappelant alors le spectateur à sa réalité présente.

Quelques années plus tôt, en 1969, Melville filmait la résistance française avec L’Armée des Ombres. Puis un peu plus tard, en 1974 Louis Malle filmait la collaboration française avec Lacombe Lucien. Deux styles et deux points de vue différents pour un même contexte : la France sous l’Occupation allemande. Le silence, la solitude, les ténèbres d’un côté avec Melville, ancien résistant lui-même qui adapte le livre de Kessel. De l’autre un certain classicisme, une esthétique réaliste avec Louis Malle qui joue à la reconstitution historique mais qui, heureusement, ne s’arrête pas là. Les deux films sont comme les deux faces d’une même pièce, esthétiquement et mythologiquement dos à dos et pourtant soudés par le contexte historique dont ils traitent. Melville délaisse enfin ses films noirs et ses gangsters, pour montrer la dignité de ceux qui se sont battus dans le silence, la peur et la mort. Le même silence que celui de son samouraï joué par Alain Delon, le silence des êtres condamnés à la solitude et à une mort certaine, comme l’annonce la toute fin du film, donnant les dates et contextes des morts des protagonistes après qu’ils aient eux-mêmes abattu leur camarade Mathilde. Il adopte ainsi une approche mythique, il fait des résistants des figures fortes, quasi-légendaires, interprétés par des corps particuliers (Lino Ventura, Simone Signoret).
L’approche de Louis Malle est plus centrée sur l’écriture, notamment de son personnage principal. C’est pourquoi il a collaboré au scénario avec le romancier Patrick Modiano. Le film raconte une petite histoire dans la grande. Ou plutôt il fait le portrait d’un jeune garçon un peu marginalisé dans son village qui exploite la grande histoire pour la sienne. Louis Malle raconte ainsi la bassesse morale et la pire des lâchetés : la plus banale. Très loin de la droiture morale des résistants de Melville, Lacombe Lucien tente d’abord d’intégrer la résistance chez qui il essuie un refus. Il se venge alors en dénonçant son professeur (membre du maquis) et intègre ainsi petit à petit un groupe de collaborateurs. Avec eux, le jeune homme participe à des opérations de la gestapo française (la gendarmerie) et jouit pleinement des privilèges de son nouveau cercle. Il s’infiltre dans le foyer d’un homme juif et de sa fille qu’il convoite. Son approche est d’abord timide puis, constatant son emprise, il s’installe progressivement dans le foyer comme un parasite. Il exige qu’on lui serve à manger et qu’on obéisse à ses ordres, sous menace de dénonciation. Le long métrage de Malle marque surtout par l’écriture de son personnage principal antipathique, qu’il filme sans aucun romantisme. Il est d’ailleurs incarné par un acteur non professionnel (contrairement à Melville qui confie ses grands rôles au gratin de l’époque). Cette esthétique réaliste, académique n’empêche pas le film d’être assez brillant, en particulier lors des séquences de repas absolument glaçantes ou aux différents moments lors desquelles la haine antisémite est violemment exprimée.
Le film est cru, rude. Il dresse un portrait bien français : Lucien Lacombe, collaborateur par intérêt. Intérêt de sentiment de supériorité, intérêt de la chair. Ces intérêts l’amèneront finalement à sauver de la déportation la jeune femme juive qu’il désire, un revirement soudain, comme celui des “résistants de la dernière heure” qui ont changé de camp lorsqu’ils ont senti le vent tourner. Les films sont des contraires, mais ont chacun une valeur historique, un rôle différent. Melville construit un mythe, celui de la France qui résiste, du maquis, de ces grands héros de l’ombre. Un mythe auquel on voudrait tous croire, que Louis Malle déconstruit cinq ans plus tard avec son film, en apportant un contrepoint historique important. Je ne voudrais cependant pas qu’on croit que je condamne L’armée des ombres, je pense que tout l’intérêt du cinéma c’est qu’il peut et doit y avoir plusieurs points de vue d’un même sujet qui coexistent, se confrontent, se complètent. Il y a bien eu des résistants sous l’occupation, ils étaient braves, courageux et se sont dressés contre l’Allemagne nazie, contre la France de Pétain. Seulement ils étaient bien seuls ces résistants. Des Lucien Lacombe il y en a eu aussi et sûrement plus … seulement c’est peut être plus dur à accepter.

On a parfois l’impression qu’il y a des sujets qui appellent des cinéastes. Ceux-là et non un autre. Pour raconter Berlin, avec lui l’Allemagne, après Rossellini et son Allemagne année zéro, qui d’autre que Wim Wenders. Né en 1945, il est l’enfant spirituel de cette nouvelle Allemagne en reconstruction, enfant des bourreaux génocidaires, d’une histoire à laquelle il n’a pourtant pas participé, construit son existence et son parcours d’artiste. Cinéaste du voyage, du déracinement, Wenders se déplace, réalise des films partout: Allemagne forcément, France, Amérique, Japon. Des films sur des paysages, sur des voyageurs, sur des quotidiens qu’il n’a pas connus. Quand il revient en Allemagne en 1987 après le succès de son film américain Paris, Texas, il réalise Les Ailes du Désir à Berlin. Des anges planent autour des habitants de la capitale allemande, coupée en deux par le mur. Ils entendent les pensées de chaque personne qu’ils suivent mais ne peuvent pas interagir avec elles.
Par la capacité d’écoute de ses anges, Wenders raconte Berlin quelques petites années avant l’écroulement du mur, des âmes solitaires, tristes, perdues comme lui. La ville est histoire d’une certaine manière, tout rappelle la guerre, que ce soit les ruines, l’immense bibliothèque ou ce mur qui conditionne tout. Wenders est même presque en avance sur l’histoire, puisque dans la séquence centrale du film, un ange décide de renoncer à sa vie immortelle et froide de témoin de l’existence humaine pour vivre vraiment. Il se retrouve alors avec un autre ange juste devant le mur et parvient à devenir humain. Le film passe alors du noir et blanc à la couleur, et avec un jeu de travelling, Wenders le fait passer de l’autre côté du mur. Il abolit métaphoriquement la barrière qui divise la ville, et l’Allemagne en deux. De mur il est aussi question dans OUI! avec ce mur d’Apartheid qui sépare la Cisjordanie d’Israël construit dans les années 2000, qui marque architecturalement la condition du peuple palestinien.

Lorsque l’on s’intéresse au cinéma palestinien, on ne peut passer à côté de ce mur, ce symbole physique de la « prison ouverte » qu’est malheureusement devenue la Palestine. Contraindre les déplacements forcément c’est contraindre la liberté, contraindre la vie et contraindre la représentation esthétique. Ce mur, les personnages du OUI! le longent comme avant eux l’ont longé des milliers de palestiniens, parmi eux Michel Khleifi accompagné de Eyal Sivan, qui l’ont filmé pour un vaste road movie documentaire : Route 181, Fragments d’un voyage en Palestine-Israël. Deux cinéastes, un palestinien, Khleifi (dont il faut impérativement voir Noces en Galilée) et un israélien, Eyal Sivan, pour un long dialogue routier tourné en 2003 alors que ce mur est en construction. S’agissant d’un film documentaire, il s’écarte du corpus choisi pour cet article, ce pourquoi je ne m’attarde pas trop dessus, je tenais simplement à le mentionner ici.

Allemagne année zéro apparaît finalement comme une évidence dans la potentialité historique du cinéma de fiction que j’essaye de dépeindre dans cet article. Pas de grande histoire, pas de romantisme, ou très peu, Rossellini fige sur la pellicule l’image de l’Allemagne au lendemain de la guerre. Il filme les ruines, la misère, le destin funeste d’un petit garçon qui finit par se jeter d’un immeuble. En 1948, le cinéaste italien retourne le regard en donnant ce point de vue, celui des allemands, pourtant grands bourreaux de cette guerre. Il rappelle qu’ici aussi il y a des victimes, des enfants à qui on a menti toute leur vie, à qui on a promis monts et merveilles, et qui se retrouvent comme orphelins, coupables de tout. C’est l’écriture de l’Histoire au présent que propose Rossellini avec un film au scénario pourtant si simple : il suit la déambulation de cet enfant, ses rencontres le temps d’une journée, jusqu’à sa décision finale. Une jeunesse sacrifiée, voilà ce que montre Rossellini de l’Allemagne de 1948. Et pour le montrer, pas besoin de grandes péripéties dramaturgiques : une ville en ruine, la réalité d’un espace-temps et les personnes qui le peuplent.

Raconter l’oppression (coloniale avec Lakhdar-Hamina, patriarcale avec Chantal Akerman)
Une guerre, une autre, celle de l’Algérie, avec Chronique des années de Braise de Mohammed Lakhdar-Hamina ressorti en août en salles. Le film connaît une certaine visibilité grâce à sa palme d’or. Il démontre, surtout au public occidental, comment la Guerre d’Algérie n’a pas éclaté par accident mais comment, au contraire, le peuple algérien a lentement et sûrement pris conscience de l’oppression coloniale de la France au lendemain de la seconde guerre mondiale. Comme son titre l’indique, il s’agit d’une chronique, divisée en six parties, de 1939 à 1954, relatant cette prise de conscience et l’organisation d’une résistance. Parmi ces trois heures de film ressort la complexité de l’organisation de ce qui donnera par la suite la Guerre d’Algérie (très bien filmée par Gillo Pontecorvo dans La Bataille d’Alger, une co-production italo-algérienne).
Le film, contre la propagande militaire française, écrit l’histoire de la colonisation avec cette vingtaine d’années. Contre la propagande coloniale de la démocratie française, Lakhdar-Hamida a une trouvaille : le personnage du fou. Face à la violence des colons français, il est le premier à ne pas se taire, à résister face à l’oppression. Les personnages d’aliénés occupent souvent une place particulière dans les films. Ici, c’est celui qui déborde du cadre, celui qui se rend moins compte des risques de la désobéissance, celui à qui on pardonne plus. Lorsque tout le peuple algérien s’agenouille devant un émissaire de l’armée française, il est le seul à rester debout. Sa résistance, d’abord marginale et peu considérée, grandit progressivement au cours du film. Les algériens sont de plus en plus nombreux à ne plus s’agenouiller, le développement de la résistance se fait ainsi autour de lui. Le film s’arrête à l’aube de la révolte algérienne et fait donc un travail historique particulier. Il recontextualise le conflit, en expliquant les processus qui y ont mené, contre le narratif officiel français qui voudrait dire qu’il s’agit d’une révolte surprise, illégitime. En France on a longtemps parlé du « problème algérien », de la situation de « crise en Algérie », comme quelque chose de passager qui se réglerait forcément. Or ce que le film montre, ce sont les origines de ce « problème », les abus de pouvoir, les violences excessives des français envers le peuple algérien. Mais aussi les origines d’un sentiment de cohésion nationale en Algérie et d’une volonté de se battre pour résister à l’oppression colonialiste française. Une libération qui sera finalement obtenue par les armes, le sang avec la Guerre d’Algérie, durant laquelle l’armée française (avec l’OAS), s’illustre par ses crimes de guerre et tortures atroces.
Mais le cinéma ne raconte pas que la guerre, l’oppression des femmes aussi, avec notamment Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman et son esthétique si particulière. 3H40 de froideur, de plans fixes pour raconter l’ennui, la souffrance retenue, la soumission de la femme. Répétition machinale des mêmes gestes, des mêmes épluchures des mêmes pommes de terre, des mêmes silences. En trois heures, qui représentent trois jours et nous donnent la très forte impression d’avoir passé trois mois dans cette cuisine froide, Chantal Akerman cristallise le mouvement de libération des femmes dans un film qui fait date. L’oppression féminine rendue palpable, concrète pour tous dans un film étouffant dans lequel l’esthétique de la cinéaste produit tout. Une esthétique du temps, de la fixité, de la lenteur, qui fait de Delphine Seyrig l’image de toutes ces femmes aliénées par un quotidien d’enfermement qui les oppresse. La narration représente la trajectoire de cette femme, Jeanne Dielman, c’est elle mais cela pourrait en être tellement d’autres. D’abord son quotidien aliénant et étouffant, puis la prise de conscience, figurée par des micro-ratés dans la dernière journée du film. Des pommes de terre trop cuites jetées, une lumière qui reste allumée, il y a comme un grain de sable dans ce mécanisme quotidien si bien huilé et chorégraphié. Et alors tout s’effondre, ou plutôt tout s’anime, lentement mais sûrement. C’est la prise de conscience muette de l’oppression jusqu’à la dernière passe et un coup de ciseau dans le dos. C’est la révolte.

Il y aurait encore tellement de films à interroger sur cette question de l’écriture d’une histoire ou d’une contre-histoire, que je citerai ici en vrac, en y revenant, pourquoi pas, dans un prochain article. Le cinéma de Pedro Costa avec son personnage de Ventura, sur l’oppression coloniale portugaise, le cinéma de fiction de Rithy Panh, avec Rendez vous avec Pol-Pot dont j’ai déjà parlé dans un précédent article, La Haine qui capte la vie de toute une génération qui habite dans les cités parisiennes, Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof sur la révolution féministe iranienne qui figure la mort du patriarcat avec un symbole final fort, Le rire et le couteau de Pedro Pinho, Atlantiques de Mati Diop, Solo de Jean-Pierre Mocky, le cinéma de Jia Zanghke qui raconte les mutations de la Chine contemporaine, le cinéma de Francisco Rosi sur les malversations du pouvoir en Italie, Vincere de Marco Bellochio, …
OUI !
C’est dans ce corpus que je voulais essayer d’inscrire Oui ! De Nadav Lapid, avec la certitude que ce film raconte notre époque, la période que nous vivons, en nous donnant peut être la clé manquante de la situation tragique que subit le peuple palestinien. Contre-écriture de l’histoire, plaçant le point de vue du côté des habitants de Tel-Aviv, en passant derrière le niveau de la propagande du régime israélien. Il montre des israéliens qui doutent, leurs remords, leurs crises existentielles sans pour autant leur pardonner. Oui ! rappelle que derrière l’armée israélienne existent ces personnes, tout en faisant un portrait violent contre ceux qui soutiennent la propagande du régime et les massacres en cours. Parce que le film montre des doutes sur le bien-fondé de la réaction militaire mais il finit aussi et surtout par montrer la complaisance, l’acceptation des horreurs commises et la complicité totale. C’est ce que Lapid semble donner comme point de vue avec son film : il montre la complexité des sentiments qui peuvent traverser les israéliens sur leur nationalité, leur identité, l’idéologie avec laquelle ils ont été élevés. L’idéologie sioniste selon laquelle les terres sur lesquels ils vivent leurs appartiennent, n’étaient pas habités avant eux. Selon laquelle les Palestiniens sont une grande menace contre laquelle il est bien normal de se défendre.
Qu’est ce qu’être israélien aujourd’hui et d’être complice, actif ou passif face aux atrocités commises ? Voici la question que pose le film, et à laquelle il tente de donner une réponse. Après avoir rappelé que derrière la propagande du régime que l’on voit au premier plan dans les médias vivent des êtres humains avec des sentiments profonds, il montre l’horreur, avec cet hymne d’une violence inouïe, composée par opportunité de carrière. Oui ! montre ainsi l’humanité derrière l’horreur absolue. Il montre aussi la complicité, la complaisance des artistes, ceux qui suivent le sens du vent, servent leurs intérêts quitte à se complaire dans l’horreur et même a y participer activement. L’horreur des massacres qui ont cours depuis le 7 octobre surtout, mais aussi l’oppression du peuple palestinien qui a lieu depuis la Nakba de 1948. C’est pour ce point de vue si particulier, qu’il est presque le premier à nous donner, que le film de Lapid me paraît aussi crucial pour comprendre l’époque que nous vivons. Il nous rappelle au passage le rôle que le cinéma peut jouer dans ce genre de moments historiques, le rôle qu’il a à jouer pour nous faire comprendre plus profondément l’être humain, l’horreur qu’il engendre, qu’il accepte, dans laquelle il se morfond. En montrant que des israéliens ont dit OUI aux massacres des palestiniens, OUI à la complaisance avec le gouvernement et sa politique génocidaire, OUI à la tuerie sans retenue, le film témoigne dans le même temps du fait même de son existence et de sa réalisation, que des israéliens ont dit NON. OUI ! n’est peut être qu’un film, mais il est l’expression de toute une constellation de sentiments, d’émotions, de comportements d’une société qui nous est assez éloignée et dont il nous donne le pouls.
Je ne sais pas quelle conclusion apporter à toutes ces réflexions qui ont maturé en moi depuis que j’ai vu le film pour la première fois à Cannes, il y a déjà plusieurs mois. Il n’y en a peut être pas l’article est sûrement bien assez long comme cela. Il y a des films qui dépassent le cadre du cinéma, de ses sièges rouges, de ses salles obscures et qui chamboulent votre vision du monde. OUI ! en fait partie, et c’est pour cela que je recommande fortement aux lecteurs de le voir.